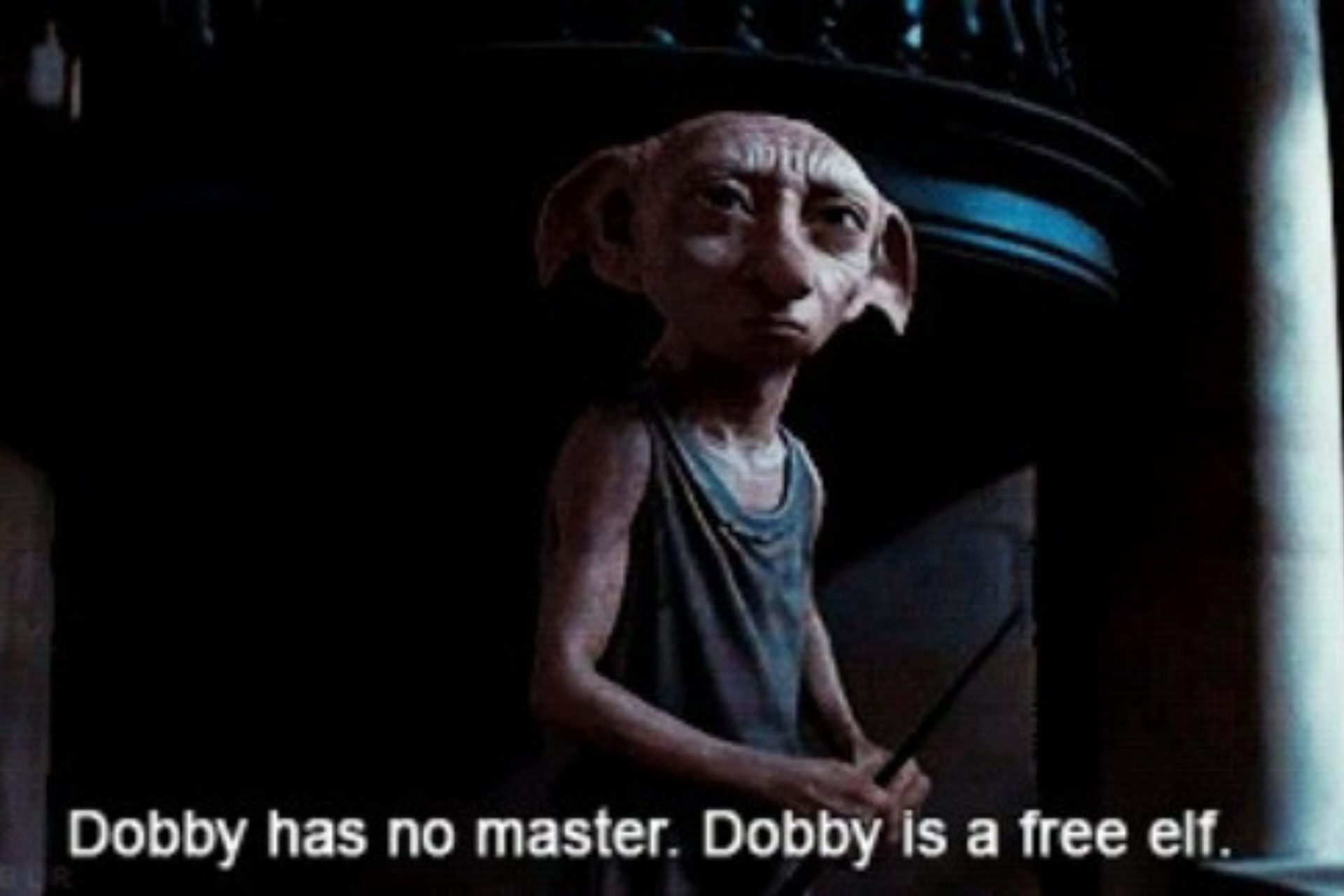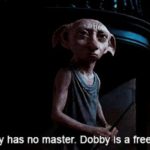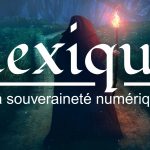En France et en Europe, on entend souvent parler de la souveraineté numérique. Nos politiques veulent défendre la protection des données, la vie privée des citoyens et des infrastructures critiques, la régulation éthique et la transparence. Nous ne voulons pas que nos données personnelles et nationales soient utilisées et dictées par des logiques Américaines et Chinoises.
Ces discours sont pourtant contradictoires avec nos habitudes et nos comportements. Parce-que dans les faits, on est quand même dépendants de leurs plateformes. Nous travaillons tous, pensons et vivons avec du numérique Chinois et Américain : Tiktok, Linkedin, Youtube, Instagram, What’s app… Nous utilisons chaque jour ces moyens de communication et d’information et ils nous sont quasiment indispensables. Refuser ces outils est devenu impossible. Les entreprises françaises utilisent Microsoft, Google, les clouds AWS et Azure, Zoom, Figma et j’en passe !
Refuser ces outils c’est ne quasiment plus travailler, et c’est devenir invisible et en retard sur tout. Et surtout c’est impossible (parce qu’il y a aussi les serveurs et les couches technologiques, le sujet est large). Les accepter c’est cautionner un modèle éthique que l’on ne veut pas mais c’est aussi renforcer la puissance politique et économique des grandes puissances dont on ne veut plus dépendre.
Bienvenue dans le double bind numérique. Nous sommes tous dans un système dont nous dépendons pour exister, tout en sachant que c’est celui qui fragilise notre autonomie politique et qui nous empêche d’être indépendant.
Notre dépendance structurelle
Notre dépendance numérique n’est pas visible à première vue. Elle est structurelle.
Les technologies américaines forment le socle de notre économie, de notre travail et de notre communication. Nous en avons bien profité et nous nous sommes bien reposés dessus. Elles sont intégrées à chaque niveau :
- A l’échelle individuelle : téléphones, ordinateurs, systèmes d’exploitation, moteurs de recherche, messageries, réseaux sociaux, photos…
- A l’échelle professionnelle (entreprises, organisations et administrations) : outils indispensables comme Microsoft, Google, AWS, outils de visioconférences et de tchat, site internet et portails web…
- A l’échelle nationale, même si nous avons des exceptions isolées comme la défense et la santé, qui conservent des structures plus souveraines pour un meilleur contrôle des données à risques…
Dans les faits, la quasi totalité de notre vie repose sur des technologies étrangères. Cette dépendance est économique et politique. Le pouvoir numérique n’est pas aux mains des États mais entre celles des entreprises qui contrôles les serveurs, les algorithmes, les IA, les puces, les flux d’informations… Et aujourd’hui ces entreprises sont Chinoises ou Américaines.
Les couches invisibles de la dépendance
Notre dépendance ne se limite pas aux outils que nous utilisons. Elle s’étend sur plusieurs couches technologiques imbriquées : les serveurs physiques, les clouds d’hébergement, les services tiers, les API, puis les plateformes et logiciels du quotidien.
Même un site “français” peut reposer sur une infrastructure américaine ou asiatique sans que cela soit visible. Une panne dans une de ces couches, un datacenter, un service cloud, un fournisseur de DNS, suffit à bloquer toute une chaîne.
Cette stratification du numérique rend la souveraineté encore plus complexe : nous ne dépendons pas seulement d’un outil ou d’un pays, mais d’un écosystème mondial interconnecté où chaque acteur repose sur un autre.
Le pouvoir d’influence mondial des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont la face la plus visible de notre dépendance. Ils ne sont pas neutres, ne le seront jamais et ne pourront pas l’être. La neutralité n’existe pas. Chaque plateforme est façonnée par une vision du monde, un modèle économique et un cadre politique.
Et ces plateformes ne se contentent pas de nous divertir et de nous donner un accès illimité aux informations mondiales, elles observent, mesurent et analysent nos comportements, nos interactions, nos habitudes de vie, nos achats… Chaque interaction alimente des modèles d’analyse comportementale d’une précision inédite. En exemple, Facebook peut connaitre votre existante même si vous n’avez pas Facebook, tellement qu’il détient des données.
Les États-Unis et la Chine, qui hébergent ces réseaux sociaux, disposent donc d’un accès privilégié à des données massives sur les comportements Européens, et les personnes qui utilisent leurs plateformes.
Ces informations peuvent orienter subtilement les messages publicitaires, politiques ou idéologiques et d’anticiper voire provoquer les tendances sociales et économiques.
Les influenceurs eux aussi participent à cette mécanique. Qu’ils en soient conscients ou non, ils deviennent des relais d’influence, parfois volontairement (partenariats, placements de produits, campagnes, tourisme, lancement de trends) et parfois inconsciemment. Les uns prêtent leur image à des campagnes commerciales ou politiques déguisées, les autres reproduisent spontanément des tendances créées par les plateformes.
Cette domination cognitive et culturelle des réseaux sociaux, nourrit directement le soft power américain et chinois. Elle influence nos comportements politiques, économiques et sociaux sans coercition, simplement par design algorithmique. C’est une économie de l’attention qui devient une vraie arme d’influence géopolitique.
L’illusion de la donnée souveraine
Si les réseaux sociaux exposent la dépendance la plus visible, celle de nos données est bien plus silencieuse et profonde. On parle souvent de “données hébergées en France” ou “dans des clouds européens”, mais dans les faits, une grande partie de nos infrastructures repose sur des acteurs étrangers. Les bâtiments sont peut-être situés à Paris ou à Francfort, mais les clés sont souvent entre les mains d’entreprises américaines ou chinoises.
Un simple incident suffit à nous rappeler cette réalité : la panne d’un datacenter d’Amazon Web Services peut bloquer des milliers de sites européens en quelques secondes. C’est toute notre économie numérique qui repose sur des serveurs que nous ne maîtrisons pas.
Cette dépendance dépasse la technique : elle touche la manière dont nous mesurons, analysons et interprétons la donnée. Nos outils d’analyse, nos solutions cloud, nos logiciels marketing sont presque tous américains. Les données européennes transitent, se comparent, se modélisent selon des standards extérieurs à nos propres politiques numériques.
Même les métiers les plus ancrés dans la donnée, SEO, web analytics, data science, évoluent dans un écosystème dont les fondations ne nous appartiennent pas. Un hébergement éloigné ou dépendant d’un cloud étranger peut ralentir un site, fausser des indicateurs ou exposer des données hors du cadre européen.
Nous parlons de souveraineté, mais nos données vivent ailleurs. Tant que nous n’aurons pas d’alternatives massives, fiables et adoptées, la “donnée souveraine” restera surtout une formule politique.
Le paradoxe Européen de réguler sans produire
L’Europe veut réguler. Avec le RGPD, Digital Markets Acts et le Digital Services Act, elle cherche à encadrer les géants du numérique et à protéger ses citoyens. Pendant que nous régulons, les États-Unis et la Chine produisent. Nous devenons un territoire de règles sans puissance industrielle correspondante.
Souveraineté juridique oui, souveraineté technologique non.
Sans alternatives crédibles, sans plateformes massivement adoptées, nous restons captifs des infrastructures des autres et ciao notre souveraineté.
Chaque retard technologique creuse l’écart entre le droit de contrôler nos données et la capacité réelle de le faire.
Un enjeu géopolitique, digital
La souveraineté numérique est un enjeu de puissance mondiale qui traverse tout le tissu digital : réseaux sociaux, cloud, data, IA, pubs, sites web, logiciels…
Les États-Unis n’imposent pas seulement leurs technologies, ils imposent leur manière de concevoir le numérique. À travers leurs GAFAM, ils fixent les standards, contrôlent les flux, orientent les innovations et dictent les formats de pensée du digital moderne.
La Chine de son côté, possède un numérique d’État, fondé sur la surveillance, la dépendance et la captation massive des données.
L’Europe elle, défend des valeurs mais ne dispose pas d’outils à la hauteur de ses ambitions. Elle a su réglementer mais elle ne fabrique pas de plateformes de remplacements.
Cette situation crée une dépendance.
La possibilité d’une autonomie numérique
Pour reprendre la main, il faudrait que l’Europe :
- Investisse massivement dans les technologies Européennes
- Crée des alternatives crédibles et les imposes
- Mutualise les moyens des États membres pour faire émerger des champions numériques
- Éduque les citoyens et les entreprises
L’indépendance totale est surement hors d’atteinte mais l’autonomie stratégique est encore possible. Et cette autonomie déterminera la place de l’Europe dans le monde.